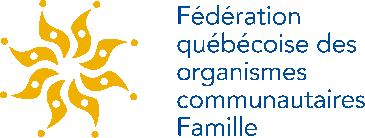- Va donner un bec à ta tante
- …
- Allez, vas-y, elle attend ton bec avant de partir !
- Veut paaaaassss !!
- Ça c’est pas poli, tu ne l’as pas vu depuis 6 mois !
Ça vous fait penser à une situation vécue ? Ou encore…
- Oh! T’as vu, c’est le Père Noël qui vient te porter tes cadeaux !
- Aaaaaahhhh!!! Whouah, Whoooah, Snif-snif,
- Si tu veux que le père Noël te donne ton cadeau, il faut que tu t’assoies sur lui…
- Nnoooooon…. Bouh, Ouinnn, Ouinnn… Snif, snif…
- Bon ben on va lui dire de repartir au Pôle Nord avec ton cadeau d’abord !
Ah, le temps des fêtes ! Les retrouvailles familiales, c’est le fun : on rit, on fête ! Mais parfois, on fait face à beaucoup de pressions ou de conventions sociales… Bien que ces situations partent souvent de bonnes intentions (faire plaisir à la tante, pousser l’enfant à dépasser sa peur du Père Noël, etc.), elles emmènent malheureusement les enfants à croire que leur consentement n’a pas d’importance et n’est pas respecté par les adultes significatifs de leur entourage… Et si cette année, on évitait de se mettre la pression pour respecter des conventions et on mettait de l’avant nos valeurs ?
Qu’est-ce que c’est le consentement ?
Selon le dictionnaire Larousse, le consentement, c’est « l’action de donner son accord à une action, à un projet ». C’est donc l’action de dire oui ou non à une proposition. De plus, le consentement est un processus. C’est-à-dire qu’il peut être retiré à tout moment.
Évidemment, il existe tout plein de nuances entre le oui et le non. Par exemple, l’enfant pourrait ne pas avoir envie de donner un bec à sa tante, mais avoir envie de lui faire un high five pour lui dire au revoir. Il faut avoir l’espace pour ressentir et exprimer ces nuances et être entendu.
On respecte le consentement si on écoute la réponse de l’autre à la proposition. Il faut aussi prendre le temps de se demander si on a réellement proposé quelque chose ou on l’a imposé.
Pour pouvoir affirmer qu’il y a eu consentement, celui-ci doit être :
- Libre de toute contrainte, pression ou menace physique, psychologique ou matérielle. Dans l’exemple du Père Noël qui va repartir au pôle Nord sans donner le cadeau à l’enfant, si l’enfant finit par dire oui pour aller s’asseoir sur le père Noël, il ou elle ne le fait pas de façon libre, car il fait face à la menace de ne pas avoir ses cadeaux.
- Éclairé ou informé. Est-ce que la personne comprend bien ce qui lui est proposé ? Est-ce qu’elle a reçu toute l’information nécessaire pour prendre une décision éclairée ?
- Enthousiaste ou authentique. Est-ce que la personne ressent un « OUI » authentique et enthousiaste ou elle se force pour correspondre aux normes sociales par exemple ?
Sur le plan légal, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à laquelle le Canada adhère, stipule à l’article 12 que « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. »

Il existe des petites exceptions où le consentement de l’enfant peut ne pas être pris en compte
Si l’intégrité physique ou psychologique ou la vie de l’enfant ou de quelqu’un d’autre est en danger. On peut donc se poser cette question avant d’agir et s’assurer que l’action que l’on souhaite poser sans son consentement vise à assurer sa sécurité ou celle des autres.
Apprentissage du consentement
Les enfants apprennent très jeunes les bases du consentement. Il faut comprendre que peu importe si l’on organise volontairement des exercices sur le consentement avec l’enfant ou pas, il ou elle l’apprendra à travers ses différentes expériences de vie. Aussi bien s’assurer qu’il ou elle l’apprenne de façon positive et non par des expériences négatives.
Apprendre le respect du consentement dès son plus jeune âge est la meilleure protection contre les agressions de toutes sortes qui pourraient survenir tant dans l’enfance qu’à l’âge adulte. En tant qu’adultes significatifs, on a un grand rôle à jouer dans ces apprentissages.
On doit évidemment s’ajuster à l’âge de l’enfant dans les exercices d’apprentissages ou dans les expériences de vie. Par exemple, pour un enfant en très bas âge qui n’a pas développé le langage verbal, on peut porter attention au langage physique. Si l’enfant montre un signe de malaise, c’est sa façon d’exprimer un non.
Et comment on s’y prend ? Voici 4 éléments essentiels :
1. Apprendre à poser des questions ouvertes et claires
Poser une question ouverte c’est laisser la liberté à l’autre d’y répondre dans ses propres mots et éviter de lui offrir des choix limités.
On peut pratiquer avec les enfants cet apprentissage à travers les activités que l’on fait déjà dans le quotidien. Apprendre comment demander pour emprunter un jouet, partager une activité ou une zone de jeu, par exemple.
Dans l’exemple de départ, quand on dit à l’enfant « Va donner un bec à ta tante », on donne un ordre, il n’y a pas de place au refus ou à une contre-proposition. On pourrait reformuler par « Est-ce que tu veux dire au revoir à ta tante ? ». Si la réponse est positive, on peut y aller avec des questions plus précises comme « Comment voudrais-tu lui dire au revoir ? » En s’adressant à l’enfant avec des questions ouvertes aussi souvent que possible, il ou elle apprendra à le faire par l’exemple.
2. Apprendre à entendre et respecter le refus, les limites ou les contre-propositions
Ce n’est pas toujours facile de se faire dire non… On peut se sentir triste, déçu ou déstabilisé par une réponse négative à une proposition qui nous enthousiasmait. En se pratiquant à le faire, on peut développer une belle posture d’accueil de l’autre, peu importe sa réponse.
On peut commencer avec des choses simples comme jouer à dire non à l’autre. Même si on le fait en contexte de jeu ou de pratique, notre cerveau s’habitue à entendre et accepter le refus de l’autre. Lors d’un refus, on peut prendre le temps de vivre l’émotion que cela suscite, prendre du recul et ensuite nommer ses émotions.
- As-tu envie d’aller manger une crème glacée avec moi ?
- Non.
- As-tu une idée d’autre activité qu’on pourrait faire ensemble ?
- Non.
- Est-ce que tu as envie de faire une autre activité avec moi ?
- Non.
- D’accord, je suis triste de ne pas faire une activité avec toi, mais fais-moi signe si tu as envie d’en faire une à un autre moment.
On peut aussi se pratiquer à formuler des contre-propositions et à exprimer des limites à l’autre :
- As-tu envie de manger de la crème glacée avec moi ?
- Non, j’ai trop froid, mais on pourrait s’allumer un feu de foyer si tu veux ?
- J’aimerais bien mais j’ai peur du feu. Si c’est toi qui l’allumes, je serais plus à l’aise. Est-ce que tu voudrais l’allumer ?
- Oui, pas de souci, je vais allumer le feu en étant prudente.
- Merci ! Veux-tu que je te propose à nouveau une crème glacée un autre jour ou tu ne préfères pas ?
- Oui, tu peux me redemander, j’aime bien la crème glacée.
3. Apprendre à lire et comprendre ses émotions.
Il faut développer tout plein d’outils pour comprendre si à l’intérieur de soi c’est un oui ou un non que l’on ressent, pour pratiquer son « J’aime, J’aime pas ».
Il existe une panoplie d’activités, d’exercices, de lectures à faire avec les enfants de tous âges pour l’exploration des émotions. Voir la liste de références à la fin de l’article.
4. Apprendre à exprimer des limites claires.
Le plus important ici, c’est que l’enfant apprenne, avec des expériences positives répétées, que ses limites sont entendues et respectées. De cette façon, il ou elle continuera tout au long de sa vie à être confiant·e dans son droit de refuser ou d’accepter quelque chose.
On peut accompagner l’enfant en l’aidant à détailler ses propos. Par exemple, si on lui propose une activité et que l’enfant répond « non », on pourrait voir avec lui ou elle pourquoi. Le pratiquer à s’exprimer librement. Est-ce parce que tu es occupé à autre chose ? Est-ce parce que tu n’aimes pas cette activité ?
Tous ces efforts de communication vous aideront à mieux vous connaître, renforcer le lien relationnel et ajouter de la nuance. Vous pourrez ainsi savoir si pour les prochaines fois il est pertinent de proposer à nouveau la même chose, si la proposition peut être modifiée ou si vous ne devez plus faire de propositions qui s’apparente à celle-ci. Communiquer ainsi permettra de se sentir écouté et respecté.
L’exploration des émotions, comme mentionné plus haut, aidera aussi à exprimer des limites, car les limites sont très souvent reliées à une émotion.
Exercices, jeux pédagogiques et références
Tous les éléments marqués d’un * sont disponibles gratuitement en prêt pour les membres de Cible Famille Brandon.
Pour l’exploration des émotions
Livres
Jeux
Activités de Cible Famille
- Ateliers de stimulation (0-12 mois, 1-2 ans, 2-3 ans, 4-5 ans)
- Parent-Guide
- Massage pour enfant 2-5 ans
- Halte-garderie communautaire
Activités à réaliser à la maison
- On peut se créer un jeu de mimes-émotions : 1 personne mime une émotion et les autres doivent deviner. Mettre l’emphase sur les 4 émotions de base : Peur, joie, tristesse et colère. On peut aussi s’amuser à mimer devant le miroir avec l’enfant. Poser des questions comme : Quand tu as mimé la peur, quelles étaient les sensations physiques dans ton corps ? J’ai mimé la tristesse, toi, est-ce que ça t’arrive d’être triste ? Qu’est-ce qui pourrait te faire vivre de la tristesse ?
Vidéos
Pour l’apprentissage du consentement
Livres
- Le consentement expliqué aux enfants, Élise Gravel
- Tout nu ! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité (pour ado) *
- Kaléidoscope est un répertoire de livres jeunesse pour un monde égalitaire.
- La collection Coup de poing
Activités et jeux
- Les envies et les limites (aux pages 95 et 96)
- La roue des 3 oui et Le jeu des 3 oui (ados)
Balado
Plateformes éducatives
Vidéos
 En bref, ce qu’on vous propose en cette période des fêtes c’est de :
En bref, ce qu’on vous propose en cette période des fêtes c’est de :
- Ne pas céder à la pression sociale si celle-ci va à l’encontre de vos valeurs et de l’écoute du consentement de votre enfant.
- Montrer l’exemple aux enfants en étant à l’écoute de leurs limites et de celles des autres.
- Favoriser la communication et les questions ouvertes.
En vous souhaitant de joyeuses fêtes !
Par Véronique Potvin, responsable TI et soutien administratif pour Cible Famille Brandon
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le sur vos réseaux sociaux !